Les images de presse en sciences sociales de la fin du XIXe siècle à nos jours : usages, imaginaires, méthodes
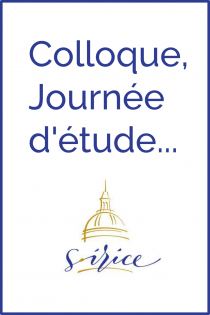
Consacrées aux images de presse en France et en Allemagne de la fin du XIXe siècle à nos jours, ces journées d’étude entendent faire un premier bilan des travaux en sciences humaines et sociales qui portent sur les usages des images et illustrations de presse et sur les imaginaires qu’elles véhiculent en mettant en perspective différentes approches et méthodes développées ces deux dernières décennies.
Les images de presse font leur apparition sous forme de gravures dans les premiers périodiques britanniques illustrés (Penny Magazine) aux alentours de 1830, avant que ne se dessine en Europe, entre 1880 et 1910, le « triomphe de l’illustration sur papier » (L. Gervereau, Images, une histoire mondiale, p. 135), marquant l’émergence complexe d’une culture de masse. Dans les années 1890, période d’intense industrialisation des médias, la France et l’Allemagne, en particulier, voient la parution des premiers magazines pionniers du photojournalisme (Berliner illustrirte Zeitung, 1892 ; La vie au grand air, La vie illustrée, 1898) qui s’accompagnent d’une première globalisation des techniques photographiques ainsi que d’échanges importants entre agences de presse des deux côtés du Rhin (Th. Gervais, La fabrique de l’information visuelle). De ce fait, ces deux pays sont la « première localisation de cette modernité éditoriale » (J.-P. Bacot, « La naissance du photojournalisme », Réseaux, p. 12).
Comprises comme un objet d’étude doté de spécificités propres, les images de presse, appréhendées au sein d’une « histoire-réseaux » (C. Delporte, Images et Politique, p. 11) regroupent une variété de supports qui ornent et illustrent la presse quotidienne, locale ou nationale, puis agencent, structurent et ordonnent la presse dite « illustrée » (presse satirique, surtout magazines) : du dessin politique à la photographie, en passant par les reproductions de tableaux, les caricatures, les photomontages, les images de « une » et les publicités illustrées. Ces images de presse constituent de fait une source très intéressante pour de nombreux domaines des sciences sociales, particulièrement à une époque où les problématiques du rôle des médias en général et de l’influence du visuel sur les opinions publiques sont omniprésentes. Reproduites dans des journaux et magazines aux tirages de plus en plus importants au cours du XXe siècle, elles sont une source de choix pour :
- les historiens du visuel – en particulier du photojournalisme et de l’image satirique (J.-C. Gardes / A. Schober (dir.), Ridiculosa. Numéro spécial. La presse satirique dans le monde, EIRIS 2013) – qui se penchent sur l’influence des images sur les sociétés, ainsi que sur la manière dont les sociétés s’approprient et (ré)utilisent les images reçues en héritage ;
- les historiens du politique pour lesquels les images de presse peuvent servir d’outil pour évaluer et appréhender les mutations des sociétés contemporaines ;
- les sémiologues et les spécialistes de communication et d’analyse du discours, replaçant les images de presse au sein de « formations discursives » créées par le journalisme, envisagé tant comme « l’un des discours producteurs de savoir dans la société » que comme une « activité discursive menée par divers groupes d’acteurs » (D. Augey, F. Demers, J.-F. Tétu, Figures du journalisme, p. 12)
- les spécialistes de linguistique computationnelle qui privilégient des approches transdisciplinaires des humanités numériques et, en particulier, le traitement automatique de larges corpus et sont attachés, pour ce faire, à développer des outils informatiques performants (océrisation, traitement numérique des images) afin d’étudier les variantes historiques de la langue et les genres textuels et visuels que représente la presse illustrée.
L’étude des imaginaires véhiculés par les images de presse des deux côtés du Rhin vise également à analyser les différentes fonctions (éducatives, informationnelles et/ou récréatives) de la presse illustrée. Vecteur de mobilisation culturelle, en particulier en période de guerre et de crise, celle-ci est-elle dès lors source de circulation de l’information, outil de déformation et/ou vecteur de désinformation ?
Enfin, dans quelle mesure les nouvelles approches et méthodes apportent-elles des éclairages complémentaires sur ces questionnements et permettent-elles d’envisager l’écriture d’une « histoire-réseaux » des images de presse dont la finalité serait une histoire de la presse illustrée ?
En se focalisant sur la France et l’Allemagne, ces journées d’étude tenteront d’apporter des premiers éléments de réponse à ces questionnements vastes et complexes qui appelleront de nombreux prolongements.
NB : Cette manifestation s’inscrit dans le cadre plus large d’un programme formation-recherche du CIERA consacré au médium spécifique de « La presse illustrée au XXe siècle / France-Allemagne : croisement des sources, méthodes et temporalités ». Depuis la fin du XIXe siècle, la presse illustrée (magazines, suppléments illustrés, presse satirique) joue, grâce à de forts tirages, un rôle très important en Europe et dans le monde en tant que média d’information et de divertissement. Elle structure, par le recours aux techniques de reproduction nouvelles qui permettent la diffusion d’une multitude de supports iconographiques, le bain visuel des sociétés contemporaines. Si la Grande-Bretagne est la terre de naissance de la presse illustrée, l’Allemagne, surtout, et la France sont considérées comme le berceau des évolutions médiatiques qui marqueront l’ensemble du paysage de la presse européenne et l’essor du photojournalisme. Ainsi ce projet espère-t-il contribuer à une meilleure compréhension de « la force tranquille de l’image fixe » (P. Ory, Le dessin de presse dans tous ses Etats, p. 27) dans la presse illustrée et, par-là, de la culture visuelle caractéristique des médias actuels.
Comité scientifique : Clémence Andreys (UFC, ELLIADD, LEA - UFR STGI), Claire Aslangul (Université Paris-Sorbonne, laboratoire SIRICE), Julien Auboussier (Université de Lyon II), Adrien Barbaresi (Académie des Sciences de Berlin-Brandebourg), Pauline Chevalier (INHA / UFC, ELLIADD, Département de Lettres), Anne Deffarges (UFC, CRIT, LEA – UFR STGI), Virginie Lethier (UFC, ELLIADD, Département de Sciences du langage), Bérénice Zunino (UFC, CRIT, Département d’Allemand)




